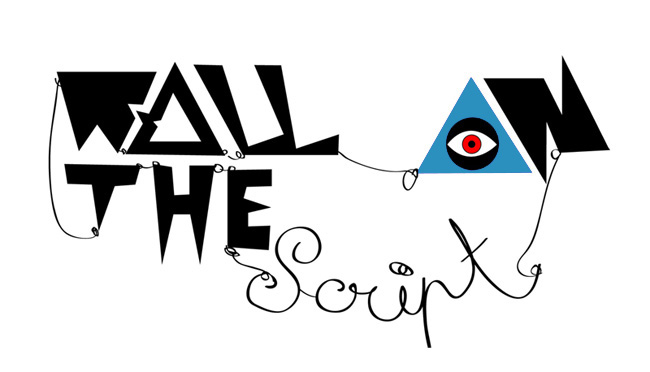Louise (Izia Higelin) naît avec des parents déjà "mauvais". Le père, Georges (Bob Geldof), est chanteur de rock (oh la la, que c’est mauvais !) et la mère, Alice (Carole Bouquet), est hippie à ses heures perdues. Lorsqu’on a 10 ans, des parents "normaux" iraient nous chercher à la sortie de l’école, nous auraient attrapé tendrement par l’épaule et nous auraient demandé attendris : "Comment s’est passé ta journée ?". Les siens ne sont pas là, ils sont ailleurs, occupés à autre chose. Entre le père qui voyage pour ses tournées et la mère qui "voyage" au bout d’une seringue, la petite apprend vite à se démerder toute seule.
La "pauvre" fille grandit assez bien malgré tout. Elle a 20 ans maintenant – et toutes ses dents. Elle a un petit ami du nom de Pablo (Arthur Dupont) et ils forment un couple heureux et joli. Ils s’aiment, elle tombe enceinte de lui. Mais sa mère tombe malade (cancer du sein) au moment où elle s’apprêtait à lui annoncer la nouvelle, comme de bien entendu. L’état s’aggrave. Ah !… un élan d’espoir! Et puis, non, ça retombe. Le ventre est déjà bien rond, elle lui annonce sur son lit de mort.

Film où l’on doit s’émouvoir, s’attrister, pleurer. Ou plutôt film où l’on "voit" s’émouvoir, s’attrister, chialer Louise quand elle n'éclate pas de rire pour deux sous. Une série de gros plans sur une figure torturée par des grimaces, des émotions presque surjouées. Combien d’oignons a-t-elle pu tranché avant de jouer toutes ces scènes malheureuses?
Pour son premier film, Patrick Mille essaye d’adapter le roman de sa compagne Justine Levy écrit trois ans auparavant ; un premier film dans lequel des chanteurs jouent aux acteurs, une couleur aseptisée, une histoire vide d’innovation se dégagent et où un scénario qui, bien qu’il soit réalisé à deux mains, reste fragile de contenu et de sens, se battant cruellement contre des blancs sonores comme visuels omniprésents.
Non, ce long-métrage ne m’a pas transporté. Si je devais juste décerner le prix de la plus "mauvaise fille", ce serait à Carole car, pour moi, elle a été l’actrice principale de ce film. Elle mériterait d’incarner, dans ce cas, au moins ce titre. Si je le pouvais, je lui offrirai même un Bouquet de félicitations.